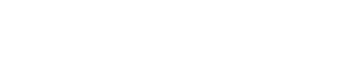Les points essentiels à retenir de cet article
-
Il existe quatre générations d’IA : l’automatisation, l’optimisation par règles, la prédiction par machine learning, et l’IA générative qui crée du contenu original.
-
L’IA fonctionne comme une « intelligence extraterrestre » qui peut résoudre des problèmes complexes mais échouer sur des tâches simples qu’un enfant de trois ans maîtrise.
-
L’IA générative agit davantage comme un partenaire de travail que comme un simple outil, permettant potentiellement à une personne seule d’obtenir des résultats équivalents à ceux d’une équipe.
-
Elle favorise des solutions plus équilibrées en permettant aux commerciaux d’explorer les aspects techniques et aux ingénieurs d’aborder les dimensions marché.
-
Une des premières barrière à l’adoption est humaine et émotionnelle, l’IA pouvant susciter résistance et peur chez les utilisateurs.
-
Pour optimiser son usage, il ne faut pas se précipiter sur l’outil mais d’abord réfléchir entre humains, puis utiliser l’IA pour critiquer et enrichir ses propres idées.
-
L’humain doit absolument garder le contrôle en restant le pilote qui décide, donne du sens et maintient un œil critique.
-
Un des plus grand dangers de l’IA est la paresse intellectuelle qu’elle peut induire chez ses utilisateurs.
-
L’IA porte en elle l’espoir de devenir un tuteur universel capable de démocratiser le savoir et l’éducation à l’échelle planétaire.
L’intelligence artificielle (IA) est sur toutes les lèvres et s’intègre de plus en plus dans nos usages quotidiens, à la maison comme au bureau. Pourtant, les opinions sont, c’est le moins qu’on puisse dire, très contrastées. L’IA, tour à tour perçue comme une véritable révolution, une menace ou un simple gadget technologique, suscite autant d’espoirs que d’interrogations dans le monde du travail.
Comment démêler le vrai du faux ? Quelle est la véritable nature de l’IA, en particulier sa forme générative, et comment peut-elle concrètement impacter l’innovation, le contenu de nos métiers et le travail de manière plus générale ?
Pour y voir plus clair et décrypter l’état de l’art, nous avons eu le plaisir d’échanger avec Charles Ayoubi, enseignant-chercheur à l’ESSEC Business School, dans le cadre du podcast « AI@WORK ». Spécialiste des processus d’innovation, de la collaboration et du partage de connaissances, Charles Ayoubi a récemment intégré l’IA à ses recherches, notamment lors de son passage à la Harvard Business School. Fort de sa double culture d’ingénieur et d’économiste de l’innovation, il nous a livré une analyse nuancée et pragmatique de cette technologie qui redéfinit déjà bien des choses.
De quelle IA parlons-nous vraiment ?
Un des premiers écueils du débat sur l’IA est la confusion qui entoure le terme lui-même, empreint d’un imaginaire très « marketing », voire « Hollywoodien ». Charles Ayoubi nous rappelle qu’il n’y a pas une seule sorte d’IA, mais plusieurs générations d’IA, chacune correspondant à une approche différente :
- L’ère de l’automatisation : La première phase, que l’on n’appelle presque plus IA aujourd’hui, consiste à exécuter des tâches prédéfinies via un code informatique.
- L’ère de l’optimisation : La deuxième génération donne des règles à la machine (les règles des échecs, par exemple) et la laisse optimiser la meilleure stratégie pour gagner sur la base de ces règles du jeu.
- L’ère de la prédiction et du Machine Learning : La troisième phase, qui constitue encore une grande partie de l’IA actuelle, ne se base plus sur des règles fixes, mais sur un apprentissage par l’essai-erreur, à la manière des « heuristiques » humaines qui nous conduisent à fonctionner aisément sans tout sur-analyser.
- L’ère de l’IA générative : La quatrième et plus récente génération, immensément popularisée par des outils comme ChatGPT ou Midjourney, ne se contente plus de prédire, mais peut générer du contenu original : textes, images, musique ou encore vidéos à partir de ses données d’entraînement.
Une « intelligence extraterrestre » au service de l’humain
Pour bien utiliser l’IA, notamment dans un cadre professionnel, il est crucial selon Charles Ayoubi de comprendre ce qu’elle peut faire, ce qu’elle ne peut pas faire et ses limites évidentes. Il nous invite aussi à nous défaire de notre « anthropomorphisme », cette tendance à comparer systématiquement l’IA à l’intelligence humaine, pour comprendre qu’elle n’a rien de comparable.
L’IA peut résoudre des problèmes d’une complexité extrême pour un humain. Pour autant, et c’est tout le paradoxe, elle peut peiner sur des tâches qu’un enfant de trois ans accomplit sans effort, comme compter le nombre de lettres dans un mot.
Voir suite de l’article sous la vidéo.
Pour visionner le podcast complet :
Leçon d’une expérience sur le terrain : l’IA, un « partenaire de travail cybernétique »
Au-delà de la théorie, comment l’IA transforme-t-elle le travail en pratique ?
Une expérience menée par Charles Ayoubi et ses collègues de Harvard auprès du géant Procter & Gamble et de ses équipes R&D offre des réponses éclairantes. En comparant des employés travaillant seuls, en équipe, seuls avec une IA, et en équipe avec une IA, l’étude a révélé des résultats surprenants.
Le principal enseignement est que l’IA générative agit bien plus comme un partenaire que comme un simple outil.
Ainsi, une personne seule, assistée par une IA, obtient des résultats en tout point similaires à une équipe humaine, grâce notamment à :
- Des solutions plus équilibrées : Un commercial peut, grâce à l’IA, développer une solution plus technique, tandis qu’un ingénieur peut explorer les aspects « marché » d’un produit.
- Un plaisir au travail accru : Les utilisateurs ressentent une satisfaction similaire au travail en équipe, pouvant « discuter » avec l’IA pour se débloquer et explorer des pistes.
Charles Ayoubi fait aussi référence à une autre étude dont les résultats restent à confirmer par d’autres travaux, mais qui montrerait que l’IA bénéficie surtout ou davantage aux personnes initialement moins performantes, leur permettant de rehausser significativement la qualité de leur travail : un véritable effet de démocratisation des compétences.
Comment bien utiliser l’IA dans le quotidien des organisations ?
Selon Charles Ayoubi, l’intégration réussie de l’IA en entreprise ne va pas de soi. L’expérience menée chez P&G lui a montré que la première barrière était humaine et très liée aux émotions : l’IA pouvait susciter de la résistance et de la peur.
Pour en tirer le meilleur parti, il esquisse néanmoins quelques bonnes pratiques et principes clés :
- Ne pas se précipiter : L’erreur la plus commune est de se jeter sur l’outil et d’accepter la première réponse, souvent séduisante, qu’il propose. Les équipes les plus performantes se révèlent être celles qui réfléchissent d’abord entre humains, puis utilisent l’IA dans un second temps pour critiquer et enrichir leurs propres idées.
- Garder le contrôle : L’humain doit rester le pilote. C’est lui qui décide, qui donne du sens et qui garde un œil critique. Le plus grand danger de l’IA, selon Charles Ayoubi, est la paresse intellectuelle qu’elle peut induire.
- Expérimenter sans cesse : Avec l’IA, il n’existe pas de « prompt magique » ni de notice universelle. La meilleure approche est, selon Charles Ayoubi, d’essayer l’IA sur une multitude de tâches, même les plus inattendues, pour découvrir son potentiel, tout en restant vigilant.
Vers quel avenir du travail nous dirigeons-nous ?
L’IA va-t-elle détruire nos emplois et balayer nos organisations ? Sans prétendre apporter une réponse définitive, Charles Ayoubi nous invite à prendre du recul. Il rappelle que chaque avancée technologique majeure, de l’écriture à Internet en passant par la calculatrice, a suscité les mêmes craintes apocalyptiques. L’histoire montre que la technologie ne détruit pas le travail, mais le transforme, déplaçant la valeur ajoutée humaine vers de nouvelles compétences. Hier, il fallait mémoriser l’information, aujourd’hui, il faut savoir la trouver, la connecter et lui donner du sens.
Mais l’IA est aussi porteuse de grands espoirs. En tant qu’enseignant, Charles Ayoubi formule lui-même l’espoir que l’IA, par sa facilité d’accès et son côté ludique, devienne un tuteur universel, capable de démocratiser le savoir et l’éducation à l’échelle planétaire, en particulier dans les zones géographiques ou auprès des populations qui n’y ont aujourd’hui pas accès.